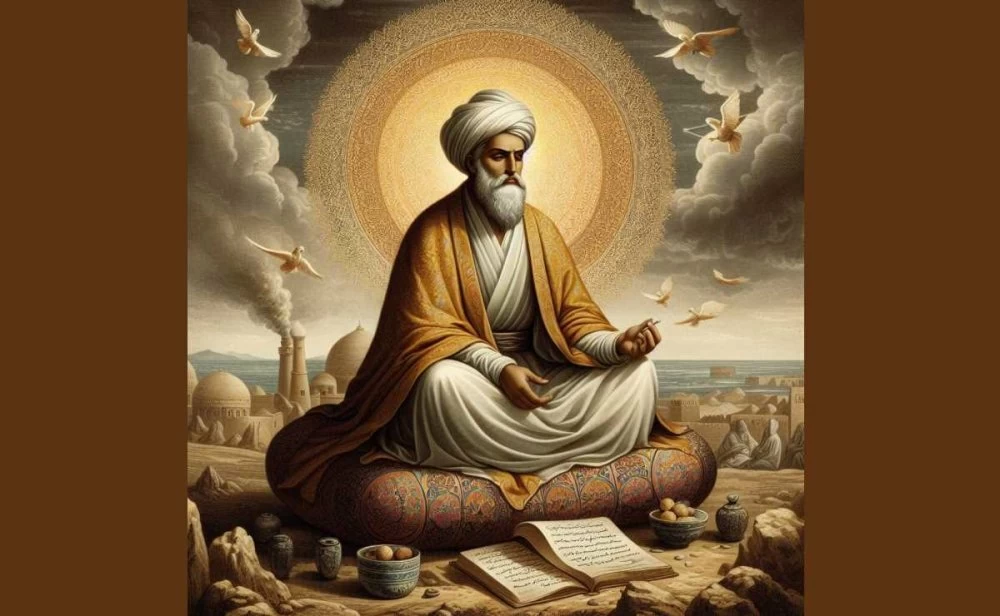Mais une telle conception enferme la réalité dans un cadre rigide, réduisant Dieu à un spectateur d’un monde régi par des lois qu’Il ne pourrait modifier. C’est cette prétention qu’Al-Ghazali attaque dans son «Tahafut al-Falasifa», où il remet en cause la nécessité absolue du lien entre cause et effet.
Si le feu brûle, ce n’est pas parce que son essence le contraint à le faire, mais parce que Dieu, à chaque instant, en décide ainsi. Rien ne prouve que ce lien soit immuable : si Dieu le voulait, l’eau pourrait embraser et le feu rafraîchir. Ce que nous percevons comme des «lois» ne sont que des habitudes instaurées par une volonté suprême, renouvelées à chaque instant. La célèbre scène du Coran, où le prophète Ibrahim (paix sur lui) est jeté dans le feu sans être consumé («Ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire», Coran 21:69), illustre cette rupture avec la pensée aristotélicienne. Ce n’est pas une exception aux lois naturelles, mais une manifestation de la réalité profonde du monde, il ne tient que par le décret divin.
Si le feu brûle, ce n’est pas parce que son essence le contraint à le faire, mais parce que Dieu, à chaque instant, en décide ainsi. Rien ne prouve que ce lien soit immuable : si Dieu le voulait, l’eau pourrait embraser et le feu rafraîchir. Ce que nous percevons comme des «lois» ne sont que des habitudes instaurées par une volonté suprême, renouvelées à chaque instant. La célèbre scène du Coran, où le prophète Ibrahim (paix sur lui) est jeté dans le feu sans être consumé («Ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire», Coran 21:69), illustre cette rupture avec la pensée aristotélicienne. Ce n’est pas une exception aux lois naturelles, mais une manifestation de la réalité profonde du monde, il ne tient que par le décret divin.
Une querelle théologique et philosophique
Avant Al-Ghazali, cette question divisait déjà les penseurs musulmans. Les mutazilites, influencés par la rationalité grecque, soutenaient que les lois naturelles ont une existence propre et que Dieu agit à travers elles sans les modifier. Pour eux, la nature du feu est de brûler et Dieu, bien que créateur de cette nature, la laisse suivre son cours.
Les ashaarites, en revanche, rejetaient cette autonomie du monde physique, affirmant que rien ne possède une force propre en dehors de la volonté divine. Ce n’est pas le pain qui nourrit, ni le couteau qui coupe, mais Dieu qui permet, à chaque instant, que ces effets se produisent. Al-Ghazali se range dans ce camp, mais en pousse la logique plus loin. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi serait-Il limité par des lois qu’Il ne pourrait transgresser ?
Les philosophes, en insistant sur la nécessité du lien entre cause et effet, finissent par enfermer Dieu dans un système où Il devient soumis à un ordre supérieur. En d’autres termes, ils font des lois naturelles une sorte de divinité parallèle, régissant le monde indépendamment de la volonté divine. Pour Al-Ghazali, cette perspective est non seulement théologiquement inacceptable, mais aussi intellectuellement intenable : si toute chose a une cause, qu’est-ce qui cause la première cause ?
Les ashaarites, en revanche, rejetaient cette autonomie du monde physique, affirmant que rien ne possède une force propre en dehors de la volonté divine. Ce n’est pas le pain qui nourrit, ni le couteau qui coupe, mais Dieu qui permet, à chaque instant, que ces effets se produisent. Al-Ghazali se range dans ce camp, mais en pousse la logique plus loin. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi serait-Il limité par des lois qu’Il ne pourrait transgresser ?
Les philosophes, en insistant sur la nécessité du lien entre cause et effet, finissent par enfermer Dieu dans un système où Il devient soumis à un ordre supérieur. En d’autres termes, ils font des lois naturelles une sorte de divinité parallèle, régissant le monde indépendamment de la volonté divine. Pour Al-Ghazali, cette perspective est non seulement théologiquement inacceptable, mais aussi intellectuellement intenable : si toute chose a une cause, qu’est-ce qui cause la première cause ?
Un monde vraiment déterminé ?
Ce débat, que l’on pourrait croire propre à la philosophie médiévale, trouve un écho inattendu dans la science moderne. Avec Newton, la vision d’un monde régi par des lois fixes et prévisibles s’est renforcée. Les planètes suivent des orbites immuables, les corps tombent selon des lois mathématiques précises, et tout semble pouvoir être anticipé avec une rigueur absolue.
Mais au XXᵉ siècle, la mécanique quantique est venue bouleverser cette certitude. Werner Heisenberg a démontré que, dans l’infiniment petit, la causalité stricte disparaît. Le principe d’incertitude prouve qu’on ne peut connaître simultanément la position et la vitesse d’une particule. Son état n’est pas fixé tant qu’il n’est pas observé, et son comportement semble obéir à des probabilités plutôt qu’à un enchaînement déterministe.
Si même la physique contemporaine doit admettre que les lois qu’elle croyait inébranlables sont en réalité des approximations, comment continuer à prétendre que la causalité est une nécessité absolue ? Le réel semble bien plus fluide et indéterminé qu’on ne l’avait imaginé.
Cela ne signifie pas que la science valide directement la thèse d’Al-Ghazali, mais cela ouvre une brèche. Et si ce que nous appelons lois n’était que des régularités statistiques, et non des impératifs figés ?
Mais au XXᵉ siècle, la mécanique quantique est venue bouleverser cette certitude. Werner Heisenberg a démontré que, dans l’infiniment petit, la causalité stricte disparaît. Le principe d’incertitude prouve qu’on ne peut connaître simultanément la position et la vitesse d’une particule. Son état n’est pas fixé tant qu’il n’est pas observé, et son comportement semble obéir à des probabilités plutôt qu’à un enchaînement déterministe.
Si même la physique contemporaine doit admettre que les lois qu’elle croyait inébranlables sont en réalité des approximations, comment continuer à prétendre que la causalité est une nécessité absolue ? Le réel semble bien plus fluide et indéterminé qu’on ne l’avait imaginé.
Cela ne signifie pas que la science valide directement la thèse d’Al-Ghazali, mais cela ouvre une brèche. Et si ce que nous appelons lois n’était que des régularités statistiques, et non des impératifs figés ?
Changer notre regard sur le monde
Si cette remise en question touche les philosophes et les scientifiques, elle interroge aussi notre perception quotidienne du réel. Nous avons instinctivement tendance à croire que les choses obéissent à des règles immuables, car nous les avons toujours observées ainsi.
Mais ce que nous percevons n’est qu’une apparence, un voile posé sur une réalité plus vaste. Dans la perspective soufie, le monde n’est pas une structure figée. Il est un flux perpétuel, une symphonie en mouvement, où chaque instant est un renouvellement du décret divin. Ce n’est pas la régularité des lois qui doit nous fasciner, mais Celui qui les instaure et peut les modifier à chaque instant.
L’homme ordinaire voit le feu et s’émerveille de sa constance. Le mystique, lui, perçoit la main de Dieu qui, à chaque seconde, décide de son pouvoir de brûler. Il ne se demande pas comment le monde fonctionne, mais pourquoi il fonctionne ainsi, et ce que cela lui révèle de la relation entre la création et le Créateur.
Al-Ghazali, en contestant la causalité nécessaire, ne fait pas qu’ébranler un concept philosophique. Il nous invite à un changement de perspective, à un éveil où le réel cesse d’être un engrenage aveugle pour devenir une scène où s’exprime la volonté divine.
Ainsi, ce que nous appelons causalité n’est peut-être qu’une illusion de l’intellect, une construction fragile face à l’immensité du mystère divin. Derrière l’apparente fixité des choses, c’est un souffle, une force invisible qui maintient l’univers en équilibre. Et ce souffle, à chaque instant, pourrait tout réordonner.
Mais ce que nous percevons n’est qu’une apparence, un voile posé sur une réalité plus vaste. Dans la perspective soufie, le monde n’est pas une structure figée. Il est un flux perpétuel, une symphonie en mouvement, où chaque instant est un renouvellement du décret divin. Ce n’est pas la régularité des lois qui doit nous fasciner, mais Celui qui les instaure et peut les modifier à chaque instant.
L’homme ordinaire voit le feu et s’émerveille de sa constance. Le mystique, lui, perçoit la main de Dieu qui, à chaque seconde, décide de son pouvoir de brûler. Il ne se demande pas comment le monde fonctionne, mais pourquoi il fonctionne ainsi, et ce que cela lui révèle de la relation entre la création et le Créateur.
Al-Ghazali, en contestant la causalité nécessaire, ne fait pas qu’ébranler un concept philosophique. Il nous invite à un changement de perspective, à un éveil où le réel cesse d’être un engrenage aveugle pour devenir une scène où s’exprime la volonté divine.
Ainsi, ce que nous appelons causalité n’est peut-être qu’une illusion de l’intellect, une construction fragile face à l’immensité du mystère divin. Derrière l’apparente fixité des choses, c’est un souffle, une force invisible qui maintient l’univers en équilibre. Et ce souffle, à chaque instant, pourrait tout réordonner.