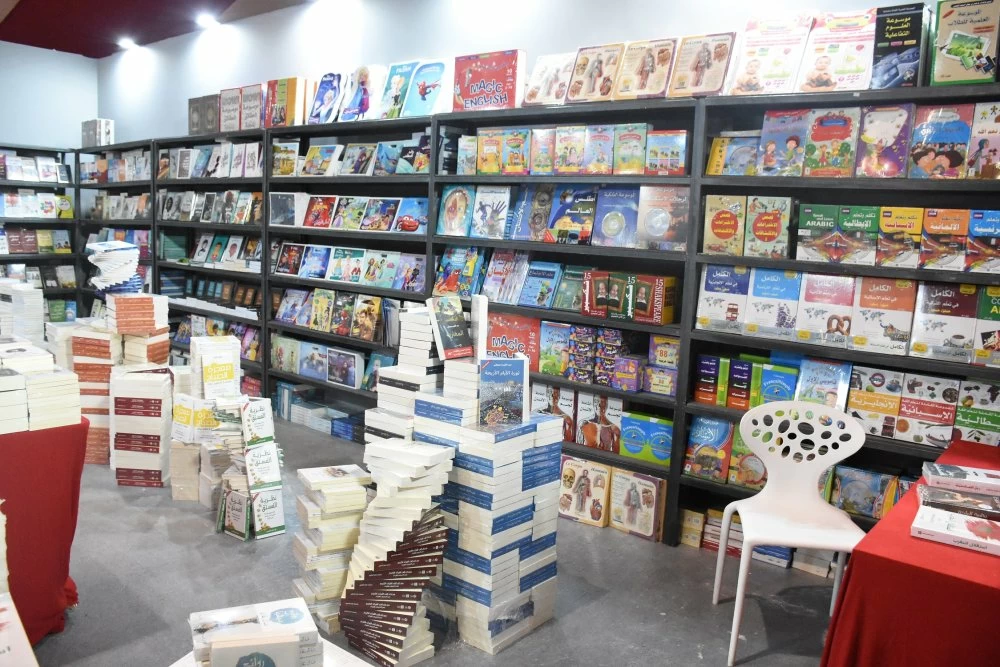Le livre marocain affiche une santé remarquable. Avec 3.725 titres publiés durant la période 2023-2024 et une augmentation de 6,98% par rapport à l’année précédente, l’édition marocaine démontre un dynamisme certain en dépit des défis du numérique. Le rapport exhaustif de la Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les études islamiques et les sciences humaines, qui est publié à l’occasion de la 30e édition du Salon international de l’édition et du livre tenu à Rabat et se poursuivant jusqu’au 27 de ce mois d’avril 2025, révèle une évolution majeure : le développement de la narration, notamment le roman et la nouvelle, au sein de la création littéraire, suggérant un passage progressif de l’ère de la poésie à celle du récit dans la littérature marocaine.
L’un des enseignements majeurs de ce rapport concerne la lente progression de l’édition numérique. Avec seulement 334 textes représentant 8,97% de la production totale, le livre électronique peine encore à dépasser le seuil symbolique des 10%. Une situation qui contraste avec les tendances observées dans d’autres pays, notamment occidentaux. Autre particularité : contrairement au livre papier où l’arabe domine largement, l’édition numérique est marquée par une plus forte présence du français, notamment dans les domaines scientifiques comme l’économie, le commerce et la finance. «Le français reste une langue privilégiée pour la recherche et les publications académiques numériques», précise le rapport.
La concentration géographique persiste
Malgré la diversification thématique et linguistique, le rapport souligne la persistance d’une forte concentration géographique de l’édition. Les régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Casablanca-Settat concentrent plus de la moitié des publications, avec respectivement 958 et 724 titres. La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma confirme sa montée en puissance avec environ 440 titres, s’imposant comme le troisième pôle éditorial du pays. «Cette répartition reflète les déséquilibres économiques et culturels qui caractérisent encore le territoire national», note le rapport, qui appelle à des politiques publiques favorisant l’émergence de pôles éditoriaux dans d’autres régions.
La renaissance de l’édition marocaine
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la production totale de publications a atteint 3.725 titres durant la période étudiée, marquant une augmentation significative de 6,98% par rapport à l’année précédente. Ce dynamisme confirme la vitalité du secteur éditorial marocain, malgré les défis économiques et les bouleversements technologiques. La création littéraire domine largement le paysage éditorial avec 721 titres, représentant 22,46% de l’ensemble des livres publiés. Suivent les études juridiques (462 titres, 14,39%), historiques (378 titres, 11,77%) et islamiques (316 titres, 9,85%). Cette diversité thématique témoigne de la richesse intellectuelle du Royaume et de l’intérêt des lecteurs pour différents domaines de la connaissance.L’un des enseignements majeurs de ce rapport concerne la lente progression de l’édition numérique. Avec seulement 334 textes représentant 8,97% de la production totale, le livre électronique peine encore à dépasser le seuil symbolique des 10%. Une situation qui contraste avec les tendances observées dans d’autres pays, notamment occidentaux. Autre particularité : contrairement au livre papier où l’arabe domine largement, l’édition numérique est marquée par une plus forte présence du français, notamment dans les domaines scientifiques comme l’économie, le commerce et la finance. «Le français reste une langue privilégiée pour la recherche et les publications académiques numériques», précise le rapport.
L’arabe en position dominante, l’amazigh en progression
La langue arabe conserve sa position hégémonique dans le paysage éditorial marocain, avec 79,43% des publications. Cette tendance confirme la poursuite et la dynamisation de l’arabisation dans le secteur de l’édition au Maroc. Le français représente désormais 16,86% des publications, suivi de l’anglais (1,83%) et de l’espagnol (0,34%). «On observe un léger recul des langues étrangères par rapport au rapport précédent», indique le document. Fait notable : la production en langue amazighe s’élève à 57 titres papier, représentant environ 1,78% du total des publications. Si ce chiffre peut sembler modeste, il témoigne d’une progression significative par rapport aux années antérieures. On constate également une augmentation marquée des publications utilisant l’alphabet Tifinagh, signe d’une volonté d’affirmation identitaire et culturelle.Du poème au roman : une révolution silencieuse
L’une des tendances les plus marquantes révélées par le rapport concerne l’évolution des genres littéraires. Au sein de la création littéraire, qui domine le paysage éditorial, on assiste à l’émergence du récit narratif, notamment le roman et la nouvelle, au détriment de la poésie, traditionnellement prédominante dans la littérature arabe et marocaine. «Nous assistons peut-être à un changement de paradigme, à un passage de l’ère de la poésie à celle du récit dans la littérature marocaine», analyse le rapport. Cette transition reflète des mutations sociales plus profondes, une évolution des pratiques de lecture et d’écriture, mais aussi l’influence croissante de la littérature mondiale contemporaine sur les créateurs marocains. Une réalité qui montre que le roman offre un espace plus vaste pour explorer les complexités. Cette évolution s’accompagne d’une plus grande visibilité internationale des romanciers marocains, dont certains ont été traduits en plusieurs langues et primés dans des concours littéraires prestigieux.La concentration géographique persiste
Malgré la diversification thématique et linguistique, le rapport souligne la persistance d’une forte concentration géographique de l’édition. Les régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Casablanca-Settat concentrent plus de la moitié des publications, avec respectivement 958 et 724 titres. La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma confirme sa montée en puissance avec environ 440 titres, s’imposant comme le troisième pôle éditorial du pays. «Cette répartition reflète les déséquilibres économiques et culturels qui caractérisent encore le territoire national», note le rapport, qui appelle à des politiques publiques favorisant l’émergence de pôles éditoriaux dans d’autres régions.