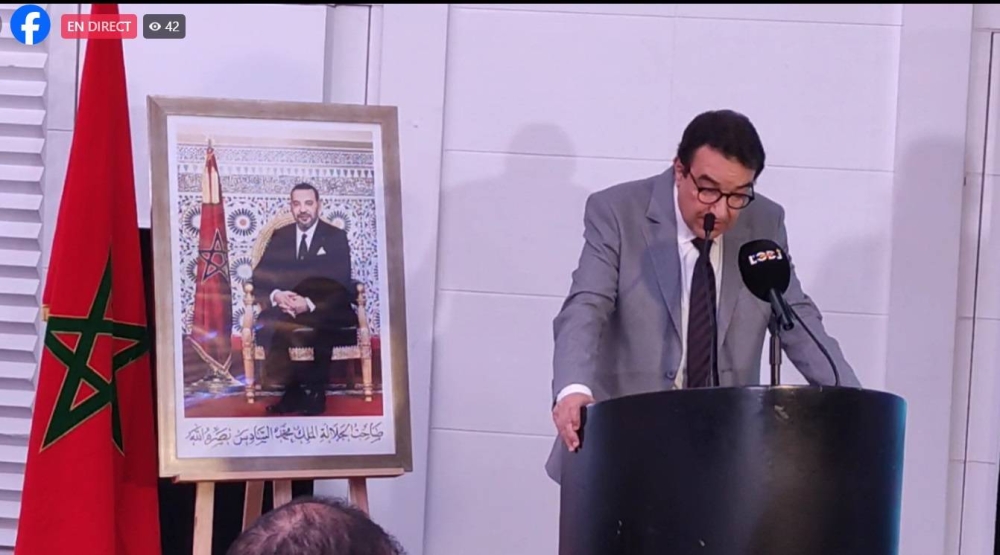Dans un contexte national marqué par l’aggravation du stress hydrique, l’information précise sur la disponibilité des ressources en eau vaut de l’or. L’État en est conscient. Un système d’information réactif, efficace et alimenté en temps réel en données provenant des différents bassins hydrauliques du Royaume permettrait aux pouvoirs publics d’agir et surtout de prévenir les difficultés d’approvisionnement des zones en manque d’eau. C’est d’ailleurs l’objectif du département de l’Eau qui planche sur la mise en place d’un Système national d’information sur l’eau (SNIE). Ce dernier viendra permettre aux différents intervenants du secteur de se saisir de l’état actuel des ressources en eau, de suivre leur évolution et d’orienter les décisions et les comportements des acteurs de l’eau vers l’efficience, la rationalité et l’utilisation durable des ressources en eau et éventuellement apporter des ajustements au Plan national de l’eau (PNE) quand cela s’avère nécessaire.
Le futur SNIE sera alimenté principalement par les systèmes d’information élaborés au niveau de chaque bassin hydraulique, comme le stipule la loi 36-15 sur l’eau. Ces systèmes seront renseignés par les informations et données disponibles au niveau des Agences des bassins hydrauliques (ABH), mais également celles provenant des différents partenaires et acteurs du cycle de l’eau (producteurs d’eau potable, gestionnaires des réseaux d’eau potable et d’irrigation, usagers de l’eau et du DPH, etc.). Le projet s’inscrit dans le cadre du Programme pour les résultats baptisé «Sécurité et résilience de l’eau au Maroc», qui bénéficie d’un concours financier de la Banque mondiale. Le programme porte ainsi sur l’opérationnalisation et l’utilisation des systèmes d’information sur l’eau au niveau des ABH et au niveau national (SNIE).
Rappelons que l’indicateur lié au décaissement du financement de ce programme consiste en l’adoption du décret établissant le SNIE et les systèmes d’information sur les ressources en eau des ABH et l’opérationnalisation de ces systèmes. Ce qui impliquera notamment l’interopérabilité entre les systèmes d’information sur les ressources en eau du SNIE et des ABH et l’interopérabilité avec les bases de données pertinentes, en plus de leur accessibilité partielle au public. L’indicateur incite également à publier l’état de la situation hydrologique annuelle, y compris les utilisations de l’eau et la qualité de l’eau dans la juridiction des ABH incluses dans le programme. Parmi les maillons forts des systèmes d’information des ABH, se trouve le système de gestion des données relatives aux ressources en eau. Ce système est en cours de mise à niveau par le département de l’Eau.
Les déficits pluviométriques qu’a connus le Maroc durant les années 2015, 2016 et 2017 ont engendré de faibles écoulements, causant ainsi une réduction des apports d’eau aux barrages. Cette situation s’est répercutée négativement sur les réserves d’eau de surface ainsi que sur les niveaux piézométriques des nappes d’eau souterraine et les débits des sources, suite à l’effet conjugué de la baisse de la recharge des nappes conséquente à la baisse des précipitations et de la pression grandissante sur cette ressource.
En dépit de cette situation hydrologique exceptionnelle, la gestion anticipative des réserves d’eau et de l’infrastructure hydraulique a permis, selon le ministère, la satisfaction des demandes en eau de la majorité des villes, des centres, des douars et des périmètres alimentés à partir des retenues de barrages. Cependant, certaines zones ont enregistré des difficultés d’approvisionnement en eau nécessitant un suivi rigoureux. En effet, en milieu rural, des difficultés d’approvisionnement en eau des populations dans plusieurs zones ont été enregistrées, en raison notamment de la baisse des niveaux piézométriques et des débits des sources, en particulier dans les zones où les nappes d’eau souterraines sont de faible capacité et sont vulnérables à la succession de plusieurs années de sécheresse.
De même, expliquent les services de Nizar Baraka, les chocs hydro-climatiques sont devenus une source majeure de volatilité macroéconomique, avec des impacts particulièrement négatifs sur le secteur agricole et créant ainsi des effets en cascade et cumulatifs dans l’ensemble de l’économie. La plupart des modèles climatiques prévoient que la tendance à la baisse des précipitations se poursuivra dans un avenir prévisible. Sur Hautes Orientations Royales, une commission interministérielle, qui s’était réunie le 18 octobre 2017 au siège du Chef du gouvernement, a chargé une commission technique de préparer un programme national proposant l’accélération des investissements dans le secteur de l’eau pour renforcer l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation, notamment pour les zones les plus touchées par le déficit hydrique.
Ainsi, le Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et d’irrigation (PNAEPI) 2020-2027 a été préparé et la convention-cadre pour sa mise en œuvre a été signée devant le Souverain, en janvier 2020. Ce programme, qui constitue la première phase du Plan nationale l’eau (PNE), est décliné en cinq axes majeurs. Il s’agit du développement de l’offre, notamment par la poursuite de la construction et/ou la surélévation de grands barrages, la construction des petits barrages pour le développement local et le développement des projets de dessalement de l’eau de mer et le renforcement et sécurisation de l’alimentation en eau potable en milieu urbain. Le deuxième axe porte, quant à lui, sur la gestion de la demande, l’économie et la valorisation de l’eau aussi bien l’eau potable, industrielle, touristique que l’eau d’irrigation. Le troisième axe prévoit la réutilisation des eaux usées épurées notamment pour l’arrosage des golfs. S’agissant du quatrième axe, il porte sur le renforcement de l’approvisionnement en eau potable en milieu rural. Enfin, le cinquième axe prévoit l’adoption d’une stratégie de communication et de sensibilisation.
Aux yeux du département de l’Eau, l’un des éléments essentiels requis pour le succès de la mise en œuvre du PNAEPI est la disponibilité des données et des informations liées à l’eau qui sont essentielles pour réussir la planification optimale des projets et permettre une meilleure prise de décision en termes de gestion et de développement durable des ressources en eau. C’est ainsi que le programme pour les résultats «Sécurité et résilience de l’Eau au Maroc» soutiendra un sous-ensemble d’activités du PNAEPI. Les limites géographiques du Programme sont définies par les zones d’action de six ABH prioritaires : Loukkos, Sebou, Bouregreg-Chaouia, Oum Er-Rbia, Tensift et Souss-Massa. Celles-ci représentent environ 80% des ressources en eau de surface du pays. Toutefois, le système d’information à mettre en place concernera l’ensemble des 10 ABH du pays.
Le futur SNIE sera alimenté principalement par les systèmes d’information élaborés au niveau de chaque bassin hydraulique, comme le stipule la loi 36-15 sur l’eau. Ces systèmes seront renseignés par les informations et données disponibles au niveau des Agences des bassins hydrauliques (ABH), mais également celles provenant des différents partenaires et acteurs du cycle de l’eau (producteurs d’eau potable, gestionnaires des réseaux d’eau potable et d’irrigation, usagers de l’eau et du DPH, etc.). Le projet s’inscrit dans le cadre du Programme pour les résultats baptisé «Sécurité et résilience de l’eau au Maroc», qui bénéficie d’un concours financier de la Banque mondiale. Le programme porte ainsi sur l’opérationnalisation et l’utilisation des systèmes d’information sur l’eau au niveau des ABH et au niveau national (SNIE).
Rappelons que l’indicateur lié au décaissement du financement de ce programme consiste en l’adoption du décret établissant le SNIE et les systèmes d’information sur les ressources en eau des ABH et l’opérationnalisation de ces systèmes. Ce qui impliquera notamment l’interopérabilité entre les systèmes d’information sur les ressources en eau du SNIE et des ABH et l’interopérabilité avec les bases de données pertinentes, en plus de leur accessibilité partielle au public. L’indicateur incite également à publier l’état de la situation hydrologique annuelle, y compris les utilisations de l’eau et la qualité de l’eau dans la juridiction des ABH incluses dans le programme. Parmi les maillons forts des systèmes d’information des ABH, se trouve le système de gestion des données relatives aux ressources en eau. Ce système est en cours de mise à niveau par le département de l’Eau.
246 stations hydrométriques à l’échelle nationale
Actuellement, le réseau de mesure hydrologique national est constitué de 246 stations hydrométriques implantées sur les principaux cours d’eau du pays et leurs affluents. Ces stations hydrométriques, sont constituées de 154 stations principales et de 92 stations secondaires (simplifiées), et un grand nombre de points de jaugeage périodiques. Quant au parc climatologique national, il est équipé d’environ 344 postes pluviométriques. Pour ce qui est du réseau de mesure piézométrique, il comprend tous les points de contrôle de la piézométrie (piézomètres, forages, puits témoin, etc.) et un réseau réduit, dont la mesure est mensuelle, qui contient les piézomètres les plus représentatifs de chaque nappe. Dans l’ensemble, le réseau piézométrique national compte quelque 1.200 piézomètres.Les déficits pluviométriques qu’a connus le Maroc durant les années 2015, 2016 et 2017 ont engendré de faibles écoulements, causant ainsi une réduction des apports d’eau aux barrages. Cette situation s’est répercutée négativement sur les réserves d’eau de surface ainsi que sur les niveaux piézométriques des nappes d’eau souterraine et les débits des sources, suite à l’effet conjugué de la baisse de la recharge des nappes conséquente à la baisse des précipitations et de la pression grandissante sur cette ressource.
En dépit de cette situation hydrologique exceptionnelle, la gestion anticipative des réserves d’eau et de l’infrastructure hydraulique a permis, selon le ministère, la satisfaction des demandes en eau de la majorité des villes, des centres, des douars et des périmètres alimentés à partir des retenues de barrages. Cependant, certaines zones ont enregistré des difficultés d’approvisionnement en eau nécessitant un suivi rigoureux. En effet, en milieu rural, des difficultés d’approvisionnement en eau des populations dans plusieurs zones ont été enregistrées, en raison notamment de la baisse des niveaux piézométriques et des débits des sources, en particulier dans les zones où les nappes d’eau souterraines sont de faible capacité et sont vulnérables à la succession de plusieurs années de sécheresse.
Les tensions sur l’eau s’aggravent de plus en plus
La limitation des ressources en eau, eu égard aux besoins importants et en continuelle augmentation, commence à devenir préoccupante dans plusieurs bassins hydrauliques du pays. Les déficits en eau habituellement enregistrés dans les bassins de l’Oriental, de l’Oum Er-Rbia et Sud-Atlasique, apparaissent un peu partout, en particulier lors des années sèches, ce qui engendre des tensions autour de l’eau. Ces tensions vont en s’aggravant au fil des années avec le développement socioéconomique et la manifestation de l’impact du changement du climat, et s’étendront petit à petit aux zones historiquement qualifiées de bien dotées en eau. En effet, le Maroc est considéré comme l’un des points chauds climatiques de la planète, les températures moyennes du pays ont monté de près de 1,4°C entre 1970 et 2019 (≈0,3°C par décennie), tandis que les précipitations ont montré une tendance à la baisse avec une variabilité croissante, des sécheresses plus fréquentes et plus intenses, et de graves inondations.De même, expliquent les services de Nizar Baraka, les chocs hydro-climatiques sont devenus une source majeure de volatilité macroéconomique, avec des impacts particulièrement négatifs sur le secteur agricole et créant ainsi des effets en cascade et cumulatifs dans l’ensemble de l’économie. La plupart des modèles climatiques prévoient que la tendance à la baisse des précipitations se poursuivra dans un avenir prévisible. Sur Hautes Orientations Royales, une commission interministérielle, qui s’était réunie le 18 octobre 2017 au siège du Chef du gouvernement, a chargé une commission technique de préparer un programme national proposant l’accélération des investissements dans le secteur de l’eau pour renforcer l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation, notamment pour les zones les plus touchées par le déficit hydrique.
Ainsi, le Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et d’irrigation (PNAEPI) 2020-2027 a été préparé et la convention-cadre pour sa mise en œuvre a été signée devant le Souverain, en janvier 2020. Ce programme, qui constitue la première phase du Plan nationale l’eau (PNE), est décliné en cinq axes majeurs. Il s’agit du développement de l’offre, notamment par la poursuite de la construction et/ou la surélévation de grands barrages, la construction des petits barrages pour le développement local et le développement des projets de dessalement de l’eau de mer et le renforcement et sécurisation de l’alimentation en eau potable en milieu urbain. Le deuxième axe porte, quant à lui, sur la gestion de la demande, l’économie et la valorisation de l’eau aussi bien l’eau potable, industrielle, touristique que l’eau d’irrigation. Le troisième axe prévoit la réutilisation des eaux usées épurées notamment pour l’arrosage des golfs. S’agissant du quatrième axe, il porte sur le renforcement de l’approvisionnement en eau potable en milieu rural. Enfin, le cinquième axe prévoit l’adoption d’une stratégie de communication et de sensibilisation.
Aux yeux du département de l’Eau, l’un des éléments essentiels requis pour le succès de la mise en œuvre du PNAEPI est la disponibilité des données et des informations liées à l’eau qui sont essentielles pour réussir la planification optimale des projets et permettre une meilleure prise de décision en termes de gestion et de développement durable des ressources en eau. C’est ainsi que le programme pour les résultats «Sécurité et résilience de l’Eau au Maroc» soutiendra un sous-ensemble d’activités du PNAEPI. Les limites géographiques du Programme sont définies par les zones d’action de six ABH prioritaires : Loukkos, Sebou, Bouregreg-Chaouia, Oum Er-Rbia, Tensift et Souss-Massa. Celles-ci représentent environ 80% des ressources en eau de surface du pays. Toutefois, le système d’information à mettre en place concernera l’ensemble des 10 ABH du pays.