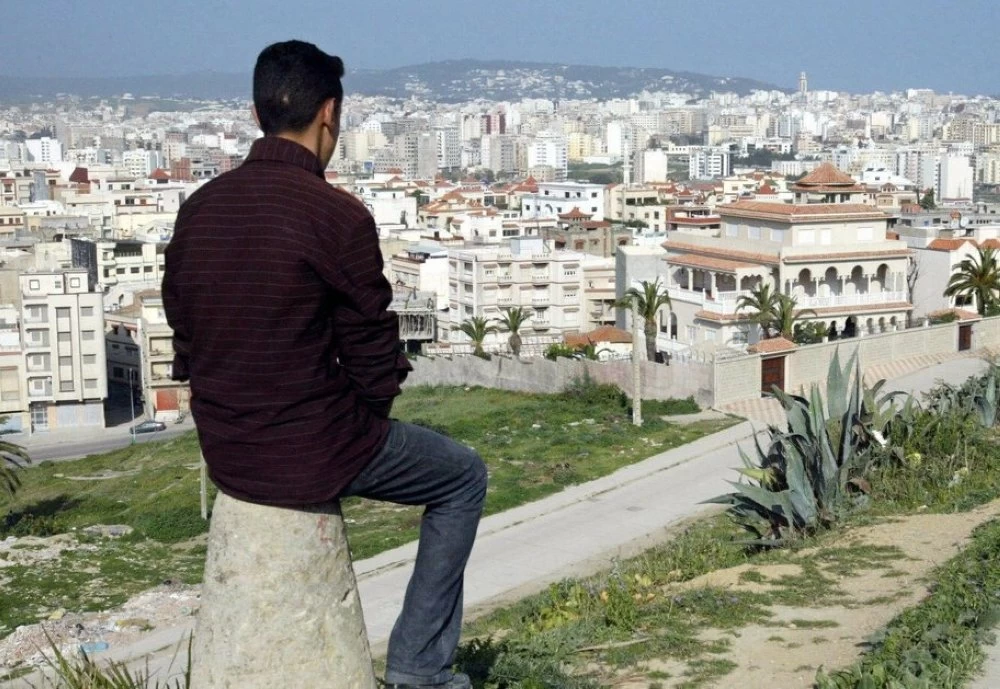L’économie marocaine ne crée pas suffisamment d’emplois. Le pays compte, selon les statistiques du HCP, plus de 1,6 million de chômeurs et près de 16 millions de personnes inactives, c’est-à-dire qui ne travaillent pas et qui ne recherche pas un travail. Soit plus de 60% de la population en âge de travailler (15 ans et plus). L’effort d’investissement public qui avoisine 30% du PIB, les différentes stratégies de développement sectorielles, les multiples programmes gouvernementaux pour stimuler l’emploi et le volume d’investissement privé ne parviennent pas, de manière structurelle, à embarquer la force de travail censée pourtant représenter l’atout principal d’un pays jeune comme le Maroc. Bon an mal an, ce sont à peine quelque 100.000 emplois qui sont créés, alors que la population en âge de travailler progresse d’environ 300.000 personnes. Si cette tendance se poursuit, le Maroc raterait sa fenêtre de tir démographique et l’opportunité d’accélérer sa croissance et son développement. Sans parler des problèmes sociaux qui se posent déjà et qui se poseront davantage à court et moyen termes : émigration irrégulière, criminalité, prolifération des activités informelles... et plus tard une population jeune qui aura vieilli, dont la prise en charge sociale sera coûteuse face à des moyens limités pour un pays qui n’aura pas emprunté, plut tôt, le train de l’émergence. Bref, le Maroc pourrait bientôt se retrouver avec un «boulet démographique» au lieu d’un dividende démographique.
Hormis les facteurs conjoncturels derrière la faiblesse des créations d’emplois, plusieurs freins structurels expliquent la situation, dont on peut citer la lente transformation de l’économie marocaine (passage des activités traditionnelles comme l’agriculture, le bâtiment et le commerce & services classiques vers des activités à haute valeur ajoutée comme l’industrie de transformation, le commerce moderne et les services technologiques) ; les lacunes de l’environnement des affaires (bureaucratie, corruption, situations de rente et de monopole, justice...) et les faiblesses du capital humain (carences de l’école publique, de la formation professionnelle et de l’enseignement universitaire).
Des réformes sont engagées depuis de nombreuses années pour traiter ces problématiques, et les efforts se poursuivent à l’image de la révision de la Charte de l’investissement, la digitalisation de l’Administration, ou encore récemment le plan gouvernemental de 14 milliards de DH pour stimuler l’emploi. Ces initiatives porteront-elles leurs fruits ? L’avenir nous le dira, mais d’ici là, une solution pourrait réduire la pression sur le marché du travail, la société et les pouvoirs publics, tout en contribuant à financer le Maroc et ses réformes : l’émigration régulée !
Si le Maroc dispose d’un excédent démographique qu’il ne parvient pas à inscrire entièrement dans sa dynamique de développement, pourquoi ne pas l’exporter, de manière sélective, encadrée et coordonnée, vers des pays dont la pyramide des âges s’est inversée et qui sont à la recherche de main-d’œuvre ? Il ne s’agirait nullement d’un aveu d’échec des politiques publiques au Maroc. Les réformes sont engagées, elles ne produiraient leurs effets que sur le long terme, en attendant, il serait tout à fait pertinent de transformer le «boulet démographique» en levier de développement, mais sous d’autres cieux.
Il ne s’agirait pas non plus de favoriser l’émigration de compétences dont le pays a besoin, comme les médecins, ingénieurs et autres profils qui affichent un déficit localement. Le taux de chômage des diplômés avoisine les 20%. Jeunes, ils sont formés dans des disciplines variées et disposent de compétences qui pourraient être recherchées ailleurs. Même des chômeurs non diplômés, voire des personnes inactives, pourraient trouver leur place dans d’autres pays. L’envoi chaque année de milliers de Marocaines au sud de l’Espagne pour la récolte de fraises est un exemple parlant.
Cette opération se fait chaque année dans le cadre d’un accord de migration circulaire initié par les gouvernements espagnol et marocain. Des accords plus globaux pour une émigration de travail à long terme ciblant certains secteurs ou métiers pourraient être noués avec plusieurs pays partenaires qui manifestent un besoin de main-d’œuvre. Il est évident que conclure et mettre en œuvre de tels accord n’est pas une mince affaire, compte tenu, entre autres, de la montée de l’extrême droite dans plusieurs pays et son refus de l’émigration. Le déficit de certaines compétences chez de nombreux profils marocains (langue, savoir-faire technique...) devra également être comblé, avant ou post émigration. Mais cette solution mérite d’être envisagée et étudiée par les pouvoirs publics au vu de ses bénéfices.
Les transferts de fonds des Marocains du monde ont frôlé les 118 milliards de DH en 2024. Ces envois permettent de réduire le déficit extérieur du Maroc (en devises), contribuent à l’investissement privé (environ 10% de ce montant va à l’investissement), mais surtout financent en grande partie le niveau de vie et les besoins sociaux de nombreuses familles marocaines, ce qui constitue un facteur de stabilité sociale pour le pays. Favoriser une émigration de travail régulée et ordonnée augmenterait cette manne financière stratégique pour le Maroc, sans parler des compétences qui seront acquises par cette communauté, dont une bonne partie sera mise, tôt ou tard, au profit du développement du Royaume.
Hormis les facteurs conjoncturels derrière la faiblesse des créations d’emplois, plusieurs freins structurels expliquent la situation, dont on peut citer la lente transformation de l’économie marocaine (passage des activités traditionnelles comme l’agriculture, le bâtiment et le commerce & services classiques vers des activités à haute valeur ajoutée comme l’industrie de transformation, le commerce moderne et les services technologiques) ; les lacunes de l’environnement des affaires (bureaucratie, corruption, situations de rente et de monopole, justice...) et les faiblesses du capital humain (carences de l’école publique, de la formation professionnelle et de l’enseignement universitaire).
Des réformes sont engagées depuis de nombreuses années pour traiter ces problématiques, et les efforts se poursuivent à l’image de la révision de la Charte de l’investissement, la digitalisation de l’Administration, ou encore récemment le plan gouvernemental de 14 milliards de DH pour stimuler l’emploi. Ces initiatives porteront-elles leurs fruits ? L’avenir nous le dira, mais d’ici là, une solution pourrait réduire la pression sur le marché du travail, la société et les pouvoirs publics, tout en contribuant à financer le Maroc et ses réformes : l’émigration régulée !
Si le Maroc dispose d’un excédent démographique qu’il ne parvient pas à inscrire entièrement dans sa dynamique de développement, pourquoi ne pas l’exporter, de manière sélective, encadrée et coordonnée, vers des pays dont la pyramide des âges s’est inversée et qui sont à la recherche de main-d’œuvre ? Il ne s’agirait nullement d’un aveu d’échec des politiques publiques au Maroc. Les réformes sont engagées, elles ne produiraient leurs effets que sur le long terme, en attendant, il serait tout à fait pertinent de transformer le «boulet démographique» en levier de développement, mais sous d’autres cieux.
Il ne s’agirait pas non plus de favoriser l’émigration de compétences dont le pays a besoin, comme les médecins, ingénieurs et autres profils qui affichent un déficit localement. Le taux de chômage des diplômés avoisine les 20%. Jeunes, ils sont formés dans des disciplines variées et disposent de compétences qui pourraient être recherchées ailleurs. Même des chômeurs non diplômés, voire des personnes inactives, pourraient trouver leur place dans d’autres pays. L’envoi chaque année de milliers de Marocaines au sud de l’Espagne pour la récolte de fraises est un exemple parlant.
Cette opération se fait chaque année dans le cadre d’un accord de migration circulaire initié par les gouvernements espagnol et marocain. Des accords plus globaux pour une émigration de travail à long terme ciblant certains secteurs ou métiers pourraient être noués avec plusieurs pays partenaires qui manifestent un besoin de main-d’œuvre. Il est évident que conclure et mettre en œuvre de tels accord n’est pas une mince affaire, compte tenu, entre autres, de la montée de l’extrême droite dans plusieurs pays et son refus de l’émigration. Le déficit de certaines compétences chez de nombreux profils marocains (langue, savoir-faire technique...) devra également être comblé, avant ou post émigration. Mais cette solution mérite d’être envisagée et étudiée par les pouvoirs publics au vu de ses bénéfices.
Les transferts de fonds des Marocains du monde ont frôlé les 118 milliards de DH en 2024. Ces envois permettent de réduire le déficit extérieur du Maroc (en devises), contribuent à l’investissement privé (environ 10% de ce montant va à l’investissement), mais surtout financent en grande partie le niveau de vie et les besoins sociaux de nombreuses familles marocaines, ce qui constitue un facteur de stabilité sociale pour le pays. Favoriser une émigration de travail régulée et ordonnée augmenterait cette manne financière stratégique pour le Maroc, sans parler des compétences qui seront acquises par cette communauté, dont une bonne partie sera mise, tôt ou tard, au profit du développement du Royaume.