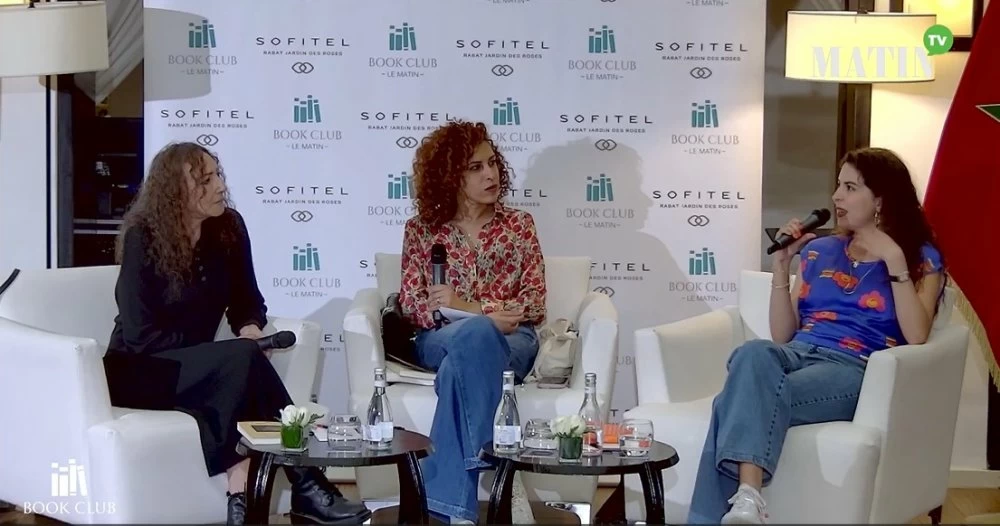Dans «La Hchouma» (Albin Michel) comme dans «Dans un seau noir» (Marsam), les héroïnes évoluent dans un univers où la violence est omniprésente : violence des hommes, violence de la société, mais aussi violence des femmes envers leurs semblables.
Pourtant, si les deux romans abordent ce thème central, chacun le fait à sa manière. Dounia Hadni explique qu’elle n’avait pas initialement l’intention d’écrire sur la violence. «J’ai essayé d’être à la hauteur de mes personnages, d’être le plus juste possible pour raconter de façon hyper honnête... Après je me rends compte que c’est un fil directeur de mon texte». Et d’ajouter : «Je pense qu’il existe une violence systémique que l’on reproduit malgré soi. Et c’est tellement fort et prégnant qu’elle rattrape le personnage de Sylia qui se met avec un homme violent», explique l’autrice.
Chez Azami, la violence entre femmes est frontale, exposée sans fard. La violence raciste que subit son personnage Ghalia, au sein même de son cocon familial, affecte tous ses choix et expériences adultes. C’est ainsi qu’elle finit par subir, à son tour, la violence conjugale : «Une violence qui va finir par devenir un élément salvateur, parce qu’elle reprend conscience des choses intériorisées», explique Bouthaina Azami.
Heureuse coïncidence : dans les deux romans, la figure du père s’éloigne des représentations traditionnelles souvent figées dans la littérature marocaine du début du XXᵉ siècle, où l’autorité patriarcale se manifestait par la froideur et la distance. Ici, les pères sont aimants, protecteurs, supports indispensables de leurs filles dans des sociétés encore traversées par des inégalités profondes. Chez Dounia Hadni, ce choix s'inspire de nombreux modèles de pères qu'elle a connus dans son entourage. Chez Bouthaina Azami, le portrait du père trouve ses racines dans sa propre expérience personnelle. L’autrice rend d’ailleurs un hommage bouleversant à son père en fin de rencontre.
Un autre thème récurrent dans les deux œuvres est celui du voyage, perçu d'abord comme une nécessité pour échapper à l'oppression, puis comme un chemin de retour vers soi et vers ses racines. Pour Sylia, c’était vraiment nécessaire de quitter la bulle dorée dans laquelle elle vivait, d'être livrée à elle-même, pour découvrir la vraie vie. «C’était un choc pour elle, même si elle maîtrisait les codes, la langue française, parce que ce n’était pas le même mode de vie, ni la même façon de se comporter. C’est à ce moment-là qu’elle commence à se rendre compte de qui elle ne veut pas être», raconte l’autrice. De son côté, l'autrice de «Dans un seau noir» estime que «le voyage représente d’abord les moments de complicité de Ghalia avec son père. Et quand son père meurt, elle a ce besoin de retourner sur ses traces. Elle refait donc le voyage à l’envers... Le voyage va surtout avoir ce rôle réparateur...», explique Bouthaina.
La question raciale et coloniale, elle aussi, est abordée avec acuité. Dounia Hadni confie que vivre en France rend difficile l’évitement de ces problématiques tant elles imprègnent le débat public : «Dès qu'on allume la télévision, ça ne parle que de cela», souligne-t-elle. Son personnage Sylia qui pensait fuir pour l’Europe des lumières s’épuise à vouloir s’intégrer coûte que coûte, sans jamais y parvenir. Bouthaina Azami, quant à elle, choisit d’explorer cette thématique depuis le Maroc, en interrogeant sans détour le passé esclavagiste et le racisme anti-noirs, aujourd'hui refoulé, de la société marocaine.
Enfin, les deux autrices n'hésitent pas à traiter de l'aliénation mentale, encore largement taboue. Dans «La Hchouma», le personnage de Silya traverse une décompensation psychique violente, vécue de l’intérieur dans une écriture qui incarne l’urgence et l’anxiété du délire. Dounia Hadni reconnaît d’ailleurs que cette partie fut la plus difficile à écrire, tant il lui tenait à cœur de restituer l'expérience du chaos mental avec acuité et authenticité. «Le but n’était pas de parler des maladies mentales ou de poser des diagnostics... Lorsqu’on pose un diagnostic, on stoppe la réflexion, comme si tous les problèmes s’expliquaient par une maladie ou un trouble», explique l’autrice. Et d’ajouter que «C’est à nous aussi de remettre en question notre système social, la façon dont fonctionne le monde du travail, les espaces qu’on accorde aux gens, les injonctions qu’on leur fait subir...» Chez Bouthaina Azami, «Ghalia, l’héroïne, a intégré si profondément la violence qu’elle en vient à la rechercher». Sa mère adoptive, quant à elle, lutte contre ses propres troubles psychiatriques, dans une spirale destructrice que la langue poétique de Bouthaina Azami parvient à rendre avec une justesse poignante.
Si les deux romans diffèrent par leur style – coup de poing pour l’une, prose brodée pour l’autre –, ils se rejoignent dans une même ambition : exprimer les douleurs tues et panser les blessures invisibles d’une société en décompensation.
Pourtant, si les deux romans abordent ce thème central, chacun le fait à sa manière. Dounia Hadni explique qu’elle n’avait pas initialement l’intention d’écrire sur la violence. «J’ai essayé d’être à la hauteur de mes personnages, d’être le plus juste possible pour raconter de façon hyper honnête... Après je me rends compte que c’est un fil directeur de mon texte». Et d’ajouter : «Je pense qu’il existe une violence systémique que l’on reproduit malgré soi. Et c’est tellement fort et prégnant qu’elle rattrape le personnage de Sylia qui se met avec un homme violent», explique l’autrice.
Chez Azami, la violence entre femmes est frontale, exposée sans fard. La violence raciste que subit son personnage Ghalia, au sein même de son cocon familial, affecte tous ses choix et expériences adultes. C’est ainsi qu’elle finit par subir, à son tour, la violence conjugale : «Une violence qui va finir par devenir un élément salvateur, parce qu’elle reprend conscience des choses intériorisées», explique Bouthaina Azami.
Heureuse coïncidence : dans les deux romans, la figure du père s’éloigne des représentations traditionnelles souvent figées dans la littérature marocaine du début du XXᵉ siècle, où l’autorité patriarcale se manifestait par la froideur et la distance. Ici, les pères sont aimants, protecteurs, supports indispensables de leurs filles dans des sociétés encore traversées par des inégalités profondes. Chez Dounia Hadni, ce choix s'inspire de nombreux modèles de pères qu'elle a connus dans son entourage. Chez Bouthaina Azami, le portrait du père trouve ses racines dans sa propre expérience personnelle. L’autrice rend d’ailleurs un hommage bouleversant à son père en fin de rencontre.
Un autre thème récurrent dans les deux œuvres est celui du voyage, perçu d'abord comme une nécessité pour échapper à l'oppression, puis comme un chemin de retour vers soi et vers ses racines. Pour Sylia, c’était vraiment nécessaire de quitter la bulle dorée dans laquelle elle vivait, d'être livrée à elle-même, pour découvrir la vraie vie. «C’était un choc pour elle, même si elle maîtrisait les codes, la langue française, parce que ce n’était pas le même mode de vie, ni la même façon de se comporter. C’est à ce moment-là qu’elle commence à se rendre compte de qui elle ne veut pas être», raconte l’autrice. De son côté, l'autrice de «Dans un seau noir» estime que «le voyage représente d’abord les moments de complicité de Ghalia avec son père. Et quand son père meurt, elle a ce besoin de retourner sur ses traces. Elle refait donc le voyage à l’envers... Le voyage va surtout avoir ce rôle réparateur...», explique Bouthaina.
La question raciale et coloniale, elle aussi, est abordée avec acuité. Dounia Hadni confie que vivre en France rend difficile l’évitement de ces problématiques tant elles imprègnent le débat public : «Dès qu'on allume la télévision, ça ne parle que de cela», souligne-t-elle. Son personnage Sylia qui pensait fuir pour l’Europe des lumières s’épuise à vouloir s’intégrer coûte que coûte, sans jamais y parvenir. Bouthaina Azami, quant à elle, choisit d’explorer cette thématique depuis le Maroc, en interrogeant sans détour le passé esclavagiste et le racisme anti-noirs, aujourd'hui refoulé, de la société marocaine.
Enfin, les deux autrices n'hésitent pas à traiter de l'aliénation mentale, encore largement taboue. Dans «La Hchouma», le personnage de Silya traverse une décompensation psychique violente, vécue de l’intérieur dans une écriture qui incarne l’urgence et l’anxiété du délire. Dounia Hadni reconnaît d’ailleurs que cette partie fut la plus difficile à écrire, tant il lui tenait à cœur de restituer l'expérience du chaos mental avec acuité et authenticité. «Le but n’était pas de parler des maladies mentales ou de poser des diagnostics... Lorsqu’on pose un diagnostic, on stoppe la réflexion, comme si tous les problèmes s’expliquaient par une maladie ou un trouble», explique l’autrice. Et d’ajouter que «C’est à nous aussi de remettre en question notre système social, la façon dont fonctionne le monde du travail, les espaces qu’on accorde aux gens, les injonctions qu’on leur fait subir...» Chez Bouthaina Azami, «Ghalia, l’héroïne, a intégré si profondément la violence qu’elle en vient à la rechercher». Sa mère adoptive, quant à elle, lutte contre ses propres troubles psychiatriques, dans une spirale destructrice que la langue poétique de Bouthaina Azami parvient à rendre avec une justesse poignante.
Si les deux romans diffèrent par leur style – coup de poing pour l’une, prose brodée pour l’autre –, ils se rejoignent dans une même ambition : exprimer les douleurs tues et panser les blessures invisibles d’une société en décompensation.