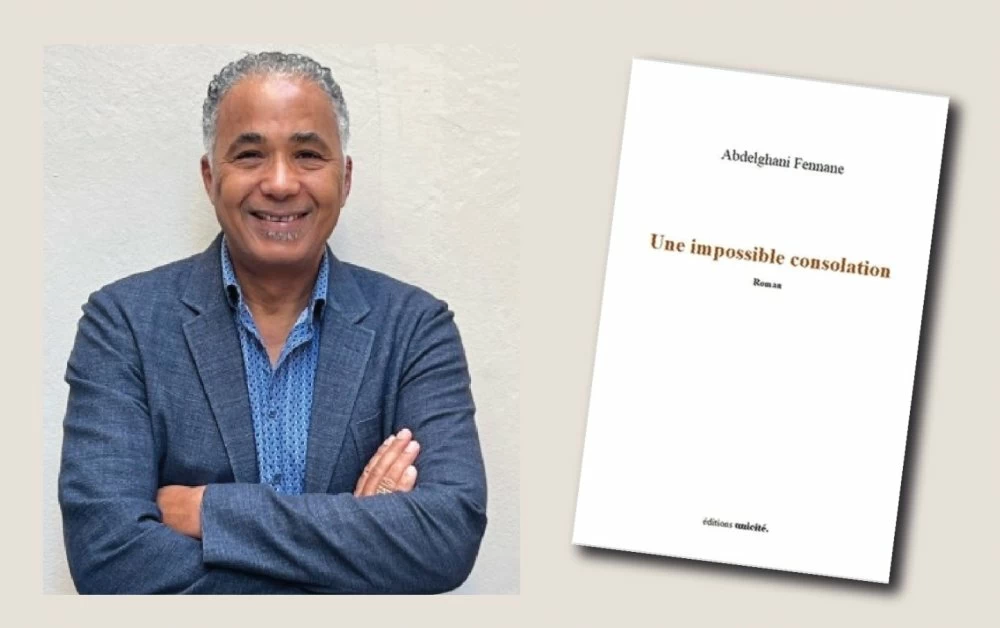Le Matin : Pourquoi avoir choisi le quartier de Diour El-Massakine comme point de départ du récit ?
Abdelghani Fennane : El-Massakine est le quartier de mon enfance. Cela fait des années que je voulais écrire ce roman. C’est devenu une nécessité avec le temps. Mon expérience de la ville de Marrakech a commencé avec ce quartier. Les livres, les films, les chansons... qui disent la ville de Marrakech n’évoquent presque jamais cet autre visage, celui de la périphérie urbaine pauvre, reléguée. Outre la stigmatisation sociale, j’avais l’impression d’habiter une ville qui n’existe pour personne. Tout le monde se tournait vers la Médina, la Place de Jamaâ El Fna, la Palmaraie... Parce que ces lieux sont chargés d’Histoire. C’est pourquoi c’était aussi un pari : écrire Marrakech à partir de la ville nouvelle.
Comment la mémoire des habitants de ce quartier dans son ensemble façonne-t-elle l’histoire du roman, et quel rôle la mémoire joue-t-elle dans la guérison des blessures sociales ?
Plus que les habitants ce sont surtout les faits que j’ai racontés. Ces faits sont la misère, la délinquance, les rixes, la peur, un sentiment d’injustice sociale, l’impuissance... Quant à la mémoire, elle garde tout : les accomplissements et les blessures. Notre rapport à la mémoire des blessures ne peut pas changer de lui-même. Il faut une thérapie. L’écriture en est une.
Le roman est-il inspiré d’histoires réelles ou s’agit-il d’une fiction pure ?
Il est un mélange des deux : réalité et fiction, fable et Histoire, mais sans perdre de vue la justesse du propos. Ce n’est pas parce qu’on recourt à la fiction que l’on peut raconter n’importe quoi. Réalité et fiction se sont mélangées dans mon roman au point qu’elles se sont emmêlées pour moi-même. J’imagine que lecteur sera lui-même confondu sur la part du «vrai» et celle du «faux». Mais cela n’affecte pas, je pense, l’intensité de mon langage ni la douleur qui émane de mon cri. Au contraire, cela lui donne plus de relief, de véracité même. C’est paradoxal, j’en suis conscient, mais c’est comme cela que je vois les choses.
Vous abordez des sujets comme la pauvreté, l’injustice sociale et la mémoire collective. Quel message souhaitez-vous transmettre à travers ces thématiques ?
Plusieurs, je pense. Notre rapport, nous les Marocains, à la mémoire et aux archives qu’il faut revoir. Le besoin d’une justice sociale dans notre société. L’utopie d’une ville résiliente, inclusive, hospitalière qui respecte tout vivant, toutes les confessions. Cela n’engage pas que la responsabilité de l’État, des élus, mais aussi celle du citoyen qui doit évoluer dans sa façon d’habiter, dans son rapport à la maison, au quartier, à la ville qu’il habite.
L’urbanisme colonial et l’évolution des quartiers périphériques sont au cœur du livre. Pensez-vous que la littérature peut jouer un rôle dans la réflexion sur la ville de demain ?
Oui, justement à travers des romans qui montrent, en les problématisant, des réalités urbaines dont on ne parle pas. Tous ces nouveaux quartiers de Marrakech : Massira, Socoma, Azli, etc. La fiction, comme la poésie ou l’art peuvent révéler des visages cachés de la ville, projeter une ville différente.
Votre roman présente une vision utopique d’une ville ouverte à la diversité. Est-ce une forme de critique de la Marrakech actuelle, ou une invitation à imaginer une ville plus humaine et plus solidaire ?
Je critique la politique ou plutôt l’absence d’une vraie politique de la ville. Il faut une vision globale, un grand projet urbain. Pour cela, il nous faut les points de vue, les approches, les propositions de l’urbaniste, de l’architecte, du politique, du paysagiste, de l’artiste...
Votre roman semble mêler enquête historique et fiction. Comment avez-vous travaillé pour reconstituer l’histoire du quartier et du Maroc ?
Connaître les origines du quartier a été pour moi une question centrale. J’ai pu, documents à l’appui et à travers des entretiens, connaître l’auteur du quartier de Diour El Massakine, le Français Alain Masson. Cette découverte m’a permis d’établir le lien entre le quartier et l’urbanisme colonial dans sa dernière phase au Maroc. Les gens pensaient que c’était de l’insalubre, ce n’était pas le cas. Il y avait une étude, des règles, une conception, une volonté de faire quelque chose d’habitable jusqu’à un certain point. Mais il y avait aussi des erreurs dont la population du quartier a payé le prix sur des générations. Je me suis justement intéressé aux origines de cette population à travers l’exemple de la tribu des Rehamna. Sur ce point, ce ne sont pas seulement les livres d’Histoire qui m’ont été utiles, mais la Aïta aussi, par exemple. J’ai d’ailleurs intitulé un des chapitres du roman «Aïta».
Plusieurs personnages du roman sont des marginaux. Comment avez-vous construit ces figures et qu’apportent-elles à votre récit ?
Les quartiers pauvres n’engendrent généralement que des marginaux : des pauvres justement, des récidivistes, des prostituées, des dealers, des drogués... Que les personnages de mon roman, à commencer par le narrateur Saïd El-Garni (Makhlouf ou Houriya, ou Khalti L’kamla), soient des marginaux est dans l’ordre des choses. La question pour moi n’était pas : qu’est-ce qu’elles vont m’apporter ? Mais comment leur rendre leur humanité, tout en gardant une certaine distance quelque part ? Pas la distance de l’arrogance, mais celle qui me permettrait de voir juste et parce que je ne suis plus pauvre aujourd’hui.
Vous citez Édouard Glissant et Jean Genet comme influences. En quoi ces auteurs ont-ils nourri votre écriture ?
Ce sont deux références essentielles pour moi. Jean Genet n’a parlé dans ses livres que de marginaux. Il dit dans «Journal d’un voleur» : «Parlant des pauvres les Arabes disent “Meskine”. J’étais mesquin.» Quant à Édouard Glissant, grand penseur-poète antillais qui a inventé entre autres la notion Relation, le monde ne peut pas être vécu, senti, pensé sans le lieu, et vice versa. C’est ce que j’ai essayé de faire dans mon roman. Je ne l’ai pas limité au quartier. Je l’ai ouvert à la ville, au pays, et au monde.
Quelle place la poésie occupe-t-elle dans votre travail littéraire ?
Une place fondamentale. Je pense que je suis d’abord poète. Je ne conçois pas l’écriture (fiction, essai, article de journal...) sans la danse des mots, le miroitement des images, le souffle, le rythme de la poésie.
Peut-on voir «Une impossible consolation» comme une forme de témoignage ou de manifeste ?
Les deux, je pense. Dans «Une impossible consolation», j’ai prêté ma voix à ceux qui ne peuvent pas parler.
Quel regard portez-vous sur la réception du livre jusqu’à présent ? Avez-vous eu des retours marquants ?
J’ai eu jusqu’à présent des retours positifs, sincères, admiratifs même. Le reste se fera dans le temps. L’important c’est de pouvoir écrire, tous les jours, de faire exister un livre si l’on pense qu’il mérite d’exister.
Pensez-vous que votre roman pourrait inspirer des actions concrètes en faveur des quartiers oubliés ?
Oui, je le pense. Modestement. Pas forcément directement à travers la lecture d’«Une impossible consolation». Les idées qui se trouvent dans un livre peuvent circuler à travers des entretiens, comme le nôtre, une conversation, un article de journal, un colloque, etc. Elles intègrent, reliées à d’autres idées, notre façon de sentir, de voir les choses et de les projeter.
Quels sont vos projets après «Une impossible consolation» ? Travaillez-vous déjà sur un autre livre ?
Je suis revenu à la poésie. La poésie me manquait. En ce moment, je lis et j’écris de la poésie.
Abdelghani Fennane : El-Massakine est le quartier de mon enfance. Cela fait des années que je voulais écrire ce roman. C’est devenu une nécessité avec le temps. Mon expérience de la ville de Marrakech a commencé avec ce quartier. Les livres, les films, les chansons... qui disent la ville de Marrakech n’évoquent presque jamais cet autre visage, celui de la périphérie urbaine pauvre, reléguée. Outre la stigmatisation sociale, j’avais l’impression d’habiter une ville qui n’existe pour personne. Tout le monde se tournait vers la Médina, la Place de Jamaâ El Fna, la Palmaraie... Parce que ces lieux sont chargés d’Histoire. C’est pourquoi c’était aussi un pari : écrire Marrakech à partir de la ville nouvelle.
Comment la mémoire des habitants de ce quartier dans son ensemble façonne-t-elle l’histoire du roman, et quel rôle la mémoire joue-t-elle dans la guérison des blessures sociales ?
Plus que les habitants ce sont surtout les faits que j’ai racontés. Ces faits sont la misère, la délinquance, les rixes, la peur, un sentiment d’injustice sociale, l’impuissance... Quant à la mémoire, elle garde tout : les accomplissements et les blessures. Notre rapport à la mémoire des blessures ne peut pas changer de lui-même. Il faut une thérapie. L’écriture en est une.
Le roman est-il inspiré d’histoires réelles ou s’agit-il d’une fiction pure ?
Il est un mélange des deux : réalité et fiction, fable et Histoire, mais sans perdre de vue la justesse du propos. Ce n’est pas parce qu’on recourt à la fiction que l’on peut raconter n’importe quoi. Réalité et fiction se sont mélangées dans mon roman au point qu’elles se sont emmêlées pour moi-même. J’imagine que lecteur sera lui-même confondu sur la part du «vrai» et celle du «faux». Mais cela n’affecte pas, je pense, l’intensité de mon langage ni la douleur qui émane de mon cri. Au contraire, cela lui donne plus de relief, de véracité même. C’est paradoxal, j’en suis conscient, mais c’est comme cela que je vois les choses.
Vous abordez des sujets comme la pauvreté, l’injustice sociale et la mémoire collective. Quel message souhaitez-vous transmettre à travers ces thématiques ?
Plusieurs, je pense. Notre rapport, nous les Marocains, à la mémoire et aux archives qu’il faut revoir. Le besoin d’une justice sociale dans notre société. L’utopie d’une ville résiliente, inclusive, hospitalière qui respecte tout vivant, toutes les confessions. Cela n’engage pas que la responsabilité de l’État, des élus, mais aussi celle du citoyen qui doit évoluer dans sa façon d’habiter, dans son rapport à la maison, au quartier, à la ville qu’il habite.
L’urbanisme colonial et l’évolution des quartiers périphériques sont au cœur du livre. Pensez-vous que la littérature peut jouer un rôle dans la réflexion sur la ville de demain ?
Oui, justement à travers des romans qui montrent, en les problématisant, des réalités urbaines dont on ne parle pas. Tous ces nouveaux quartiers de Marrakech : Massira, Socoma, Azli, etc. La fiction, comme la poésie ou l’art peuvent révéler des visages cachés de la ville, projeter une ville différente.
Votre roman présente une vision utopique d’une ville ouverte à la diversité. Est-ce une forme de critique de la Marrakech actuelle, ou une invitation à imaginer une ville plus humaine et plus solidaire ?
Je critique la politique ou plutôt l’absence d’une vraie politique de la ville. Il faut une vision globale, un grand projet urbain. Pour cela, il nous faut les points de vue, les approches, les propositions de l’urbaniste, de l’architecte, du politique, du paysagiste, de l’artiste...
Votre roman semble mêler enquête historique et fiction. Comment avez-vous travaillé pour reconstituer l’histoire du quartier et du Maroc ?
Connaître les origines du quartier a été pour moi une question centrale. J’ai pu, documents à l’appui et à travers des entretiens, connaître l’auteur du quartier de Diour El Massakine, le Français Alain Masson. Cette découverte m’a permis d’établir le lien entre le quartier et l’urbanisme colonial dans sa dernière phase au Maroc. Les gens pensaient que c’était de l’insalubre, ce n’était pas le cas. Il y avait une étude, des règles, une conception, une volonté de faire quelque chose d’habitable jusqu’à un certain point. Mais il y avait aussi des erreurs dont la population du quartier a payé le prix sur des générations. Je me suis justement intéressé aux origines de cette population à travers l’exemple de la tribu des Rehamna. Sur ce point, ce ne sont pas seulement les livres d’Histoire qui m’ont été utiles, mais la Aïta aussi, par exemple. J’ai d’ailleurs intitulé un des chapitres du roman «Aïta».
Plusieurs personnages du roman sont des marginaux. Comment avez-vous construit ces figures et qu’apportent-elles à votre récit ?
Les quartiers pauvres n’engendrent généralement que des marginaux : des pauvres justement, des récidivistes, des prostituées, des dealers, des drogués... Que les personnages de mon roman, à commencer par le narrateur Saïd El-Garni (Makhlouf ou Houriya, ou Khalti L’kamla), soient des marginaux est dans l’ordre des choses. La question pour moi n’était pas : qu’est-ce qu’elles vont m’apporter ? Mais comment leur rendre leur humanité, tout en gardant une certaine distance quelque part ? Pas la distance de l’arrogance, mais celle qui me permettrait de voir juste et parce que je ne suis plus pauvre aujourd’hui.
Vous citez Édouard Glissant et Jean Genet comme influences. En quoi ces auteurs ont-ils nourri votre écriture ?
Ce sont deux références essentielles pour moi. Jean Genet n’a parlé dans ses livres que de marginaux. Il dit dans «Journal d’un voleur» : «Parlant des pauvres les Arabes disent “Meskine”. J’étais mesquin.» Quant à Édouard Glissant, grand penseur-poète antillais qui a inventé entre autres la notion Relation, le monde ne peut pas être vécu, senti, pensé sans le lieu, et vice versa. C’est ce que j’ai essayé de faire dans mon roman. Je ne l’ai pas limité au quartier. Je l’ai ouvert à la ville, au pays, et au monde.
Quelle place la poésie occupe-t-elle dans votre travail littéraire ?
Une place fondamentale. Je pense que je suis d’abord poète. Je ne conçois pas l’écriture (fiction, essai, article de journal...) sans la danse des mots, le miroitement des images, le souffle, le rythme de la poésie.
Peut-on voir «Une impossible consolation» comme une forme de témoignage ou de manifeste ?
Les deux, je pense. Dans «Une impossible consolation», j’ai prêté ma voix à ceux qui ne peuvent pas parler.
Quel regard portez-vous sur la réception du livre jusqu’à présent ? Avez-vous eu des retours marquants ?
J’ai eu jusqu’à présent des retours positifs, sincères, admiratifs même. Le reste se fera dans le temps. L’important c’est de pouvoir écrire, tous les jours, de faire exister un livre si l’on pense qu’il mérite d’exister.
Pensez-vous que votre roman pourrait inspirer des actions concrètes en faveur des quartiers oubliés ?
Oui, je le pense. Modestement. Pas forcément directement à travers la lecture d’«Une impossible consolation». Les idées qui se trouvent dans un livre peuvent circuler à travers des entretiens, comme le nôtre, une conversation, un article de journal, un colloque, etc. Elles intègrent, reliées à d’autres idées, notre façon de sentir, de voir les choses et de les projeter.
Quels sont vos projets après «Une impossible consolation» ? Travaillez-vous déjà sur un autre livre ?
Je suis revenu à la poésie. La poésie me manquait. En ce moment, je lis et j’écris de la poésie.