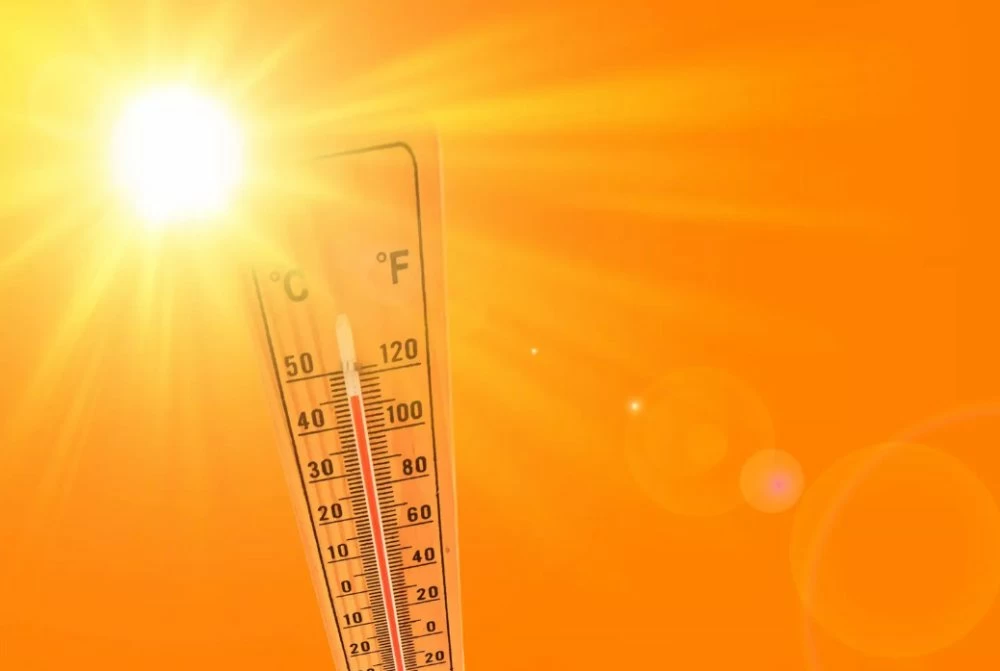La Direction générale de la météorologie (DGM) a levé le voile, vendredi dernier à Rabat, sur les grandes tendances climatiques ayant marqué l’année 2024 au Maroc. Le constat est sans appel : 2024 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée dans le Royaume, avec une anomalie thermique moyenne de +1,49 °C par rapport à la normale 1991-2020. Un chiffre bien au-dessus de l’anomalie mondiale, estimée à +0,67 °C.
Le rapport, présenté lors d’une journée d’information présidée par le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, fait état d’un climat de plus en plus instable, avec une fréquence accrue des événements extrêmes. Cette cinquième édition annuelle du document s’est imposée comme une référence nationale et internationale, à la croisée de la science, de la gouvernance et de la planification stratégique.
«Ce rapport n’est pas seulement un document technique. C’est un véritable outil d’aide à la décision, qui oriente les politiques économiques, sociales et territoriales du pays», a souligné Nizar Baraka.
Le rapport, présenté lors d’une journée d’information présidée par le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, fait état d’un climat de plus en plus instable, avec une fréquence accrue des événements extrêmes. Cette cinquième édition annuelle du document s’est imposée comme une référence nationale et internationale, à la croisée de la science, de la gouvernance et de la planification stratégique.
«Ce rapport n’est pas seulement un document technique. C’est un véritable outil d’aide à la décision, qui oriente les politiques économiques, sociales et territoriales du pays», a souligné Nizar Baraka.
Des pics de chaleur jamais atteints et une sécheresse historique
Le Rapport souligne que les mois de janvier et de novembre 2024 ont connu des températures inédites pour ces périodes de l’année. Même si l’été a été, globalement, moins chaud qu’en 2023, il a été marqué par plusieurs vagues de chaleur intenses, avec des records journaliers dépassant les 47 °C : 47,7 °C à Béni Mellal, 47,6 °C à Marrakech le 23 juillet.
Ces hausses, particulièrement marquées en automne et en hiver, s’inscrivent dans la tendance globale du réchauffement climatique. À l’échelle planétaire, la barre symbolique des +1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle a été franchie en 2024.
Côté précipitations, 2024 confirme la persistance de la sécheresse pour la sixième année consécutive, avec un déficit national moyen de -24,8%. Le constat est encore plus grave sur l’année hydrologique agricole 2023-2024, qualifiée de plus sèche depuis les années 1960, avec un déficit atteignant -46,64%.
Quelques épisodes de pluies intenses ont toutefois été observés localement, notamment en septembre dans le Sud-Est, l’Oriental, l’Atlas et la région de Tata, provoquant des crues soudaines et des inondations meurtrières. Ces événements extrêmes ont même mené à une réapparition spectaculaire du lac Iriqui, disparu depuis plus d’un demi-siècle.
«L’alternance entre des périodes de sécheresse prolongée et des pluies extrêmes amplifie les contrastes climatiques et accroît les risques agricoles, hydrologiques et sociaux», a souligné Mohamed Dkhissi, directeur général de la Météorologie lors de la présentation du Rapport.
Ces hausses, particulièrement marquées en automne et en hiver, s’inscrivent dans la tendance globale du réchauffement climatique. À l’échelle planétaire, la barre symbolique des +1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle a été franchie en 2024.
Côté précipitations, 2024 confirme la persistance de la sécheresse pour la sixième année consécutive, avec un déficit national moyen de -24,8%. Le constat est encore plus grave sur l’année hydrologique agricole 2023-2024, qualifiée de plus sèche depuis les années 1960, avec un déficit atteignant -46,64%.
Quelques épisodes de pluies intenses ont toutefois été observés localement, notamment en septembre dans le Sud-Est, l’Oriental, l’Atlas et la région de Tata, provoquant des crues soudaines et des inondations meurtrières. Ces événements extrêmes ont même mené à une réapparition spectaculaire du lac Iriqui, disparu depuis plus d’un demi-siècle.
«L’alternance entre des périodes de sécheresse prolongée et des pluies extrêmes amplifie les contrastes climatiques et accroît les risques agricoles, hydrologiques et sociaux», a souligné Mohamed Dkhissi, directeur général de la Météorologie lors de la présentation du Rapport.
Une production agricole frappée de plein fouet
Le secteur agricole, déjà affaibli par plusieurs campagnes déficitaires, paie un lourd tribut. La production céréalière a chuté de 43% par rapport à la campagne précédente. Seules certaines cultures arboricoles et maraîchères ont pu tirer profit des pluies tardives survenues en février.
Le manque de neige, les températures élevées et la rareté des pluies ont aussi aggravé la situation de stress hydrique, affectant à la fois l’irrigation agricole et l’approvisionnement en eau potable dans plusieurs régions.
Face à ces bouleversements climatiques, la DGM insiste sur la nécessité d’intégrer l’information climatique dans toutes les politiques publiques. Selon Nizar Baraka, «l’environnement devient un levier incontournable de planification, et les données climatiques doivent guider les investissements et les choix stratégiques, notamment dans les secteurs sensibles comme l’eau, l’agriculture et l’urbanisme».
Le Rapport plaide également pour l’innovation technologique au service de l’adaptation, en misant sur le renforcement des réseaux de surveillance terrestres et marins ainsi que la satellisation des données.
Le document identifie plusieurs axes d’intervention prioritaires. Il s’agit de moderniser les systèmes d’alerte précoce, optimiser la gestion de l’eau en situation de pénurie, soutenir les pratiques agricoles résilientes et renforcer la protection des populations les plus exposées.
La DGM conclut son Rapport par un appel à la mobilisation de l’ensemble des acteurs : pouvoirs publics, secteur privé, chercheurs et société civile. L’objectif : Construire une résilience nationale face aux aléas climatiques de plus en plus intenses et fréquents.
Le manque de neige, les températures élevées et la rareté des pluies ont aussi aggravé la situation de stress hydrique, affectant à la fois l’irrigation agricole et l’approvisionnement en eau potable dans plusieurs régions.
Face à ces bouleversements climatiques, la DGM insiste sur la nécessité d’intégrer l’information climatique dans toutes les politiques publiques. Selon Nizar Baraka, «l’environnement devient un levier incontournable de planification, et les données climatiques doivent guider les investissements et les choix stratégiques, notamment dans les secteurs sensibles comme l’eau, l’agriculture et l’urbanisme».
Le Rapport plaide également pour l’innovation technologique au service de l’adaptation, en misant sur le renforcement des réseaux de surveillance terrestres et marins ainsi que la satellisation des données.
Le document identifie plusieurs axes d’intervention prioritaires. Il s’agit de moderniser les systèmes d’alerte précoce, optimiser la gestion de l’eau en situation de pénurie, soutenir les pratiques agricoles résilientes et renforcer la protection des populations les plus exposées.
La DGM conclut son Rapport par un appel à la mobilisation de l’ensemble des acteurs : pouvoirs publics, secteur privé, chercheurs et société civile. L’objectif : Construire une résilience nationale face aux aléas climatiques de plus en plus intenses et fréquents.