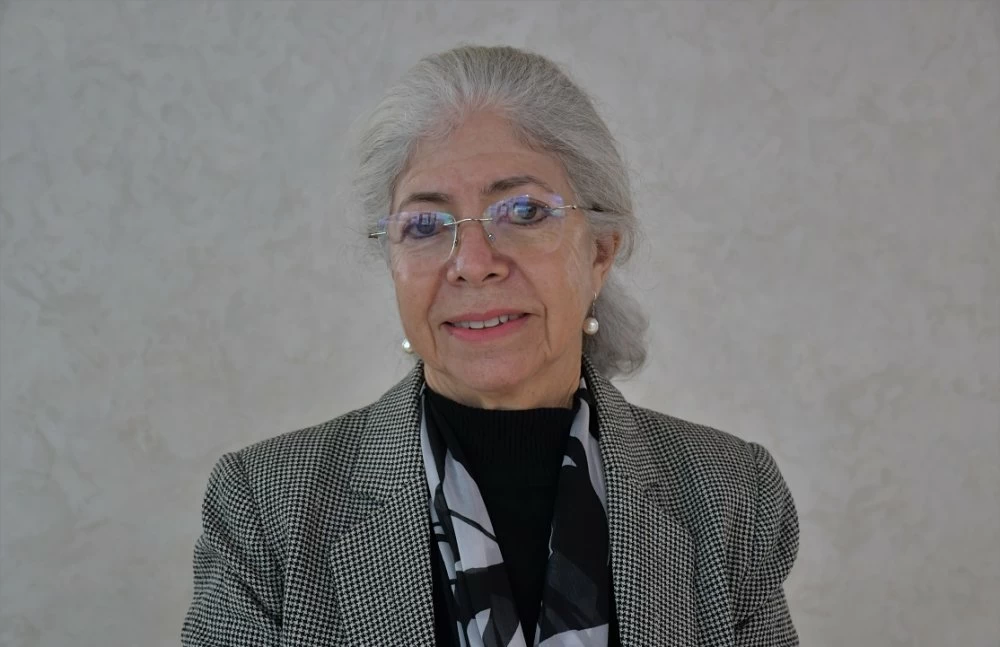Le Matin : Tout d’abord, rappelez-nous comment est née la dynamique «Pour une école de l’égalité» et quels constats ont motivé sa création ?
Widad Bouab : La dynamique «Pour une école de l’égalité» est née suite à l’initiative citoyenne lancée, sous le même intitulé, par l’Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM) en décembre 2022, et qui a été soutenue par des centaines d’associations féministes, de défense des droits humains et de développement, ainsi que par les syndicats de l’enseignement, les organismes représentant les inspecteur(trice)s pédagogiques, les associations de professeur(e)s de diverses disciplines, ainsi que les fédérations des associations de parents d’élèves.
Cette initiative a également bénéficié d’un soutien particulier d’anciens ministres de l’Éducation nationale. Toutes ces parties s’entendaient sur le fait que, malgré les nombreuses réformes juridiques et institutionnelles qui se sont succédé au Maroc en faveur de l’égalité des sexes, et malgré les progrès réalisés en termes d’augmentation des taux de scolarisation et de réduction des disparités entre les sexes, l’école ne joue pas encore pleinement son rôle dans l’éducation à l’égalité. Bien au contraire, les stéréotypes sexistes sont encore largement véhiculés par les différents intervenants et acteurs pédagogiques dans les espaces scolaires d’éducation et de formation.
Les activités menées par l’ADFM dans le cadre de cette initiative étaient :
• Élaboration d’un mémorandum «Pour l’école de l’égalité entre les deux sexes».
• Présentation du mémorandum au ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports en décembre 2022.
• Signature d’un appel par environ 150 associations et réseaux.
• Rencontre et journée d’étude avec les parlementaires de la Commission éducation, culture et communication de la Chambre des représentants en décembre 2022.
• Lancement d’une campagne de sensibilisation à l’échelle nationale.
• Organisation d’une table ronde le 24 janvier 2023 à Rabat, à l’occasion de la Journée internationale de l’éducation. Lors de cette table ronde, la discussion a montré la nécessité d’un travail de longue haleine, d’une collaboration et d’une coordination qui s’inscrivent dans la durée entre les ONG travaillant sur ce dossier. C’est de là qu’est née l’idée de création d’une dynamique que nous avons intitulée «Pour une école de l’égalité», et qui regroupe différentes ONG. Elle a été créée dans un contexte marqué, au niveau du système éducatif, par le programme gouvernemental (2021-2026), la loi-cadre sur l’éducation et la formation qui met en exergue «la nouvelle école», la Feuille de route pour les prochaines années et l’appel émanant du «Sommet de l’ONU sur la transformation de l’éducation» organisé en septembre 2022, avec la participation du Maroc, sur la question de «la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des filles et des femmes dans et par l’éducation».
Quels sont les objectifs concrets que vous espérez atteindre à court et moyen terme grâce à cette initiative ?
La dynamique vise la promotion de la culture de l’égalité dans la société en se focalisant sur le système éducatif en tant que vecteur principal de socialisation. La synergie des efforts inscrits dans la durée des différentes composantes de la dynamique constituerait un effet multiplicateur nécessaire pour atteindre les objectifs escomptés, étant donné la complexité de la problématique. En effet, la promotion de la culture de l’égalité est un processus lent et long, car elle concerne les mentalités.
Les objectifs à court et moyen terme sont de sensibiliser les intervenant(e)s dans le domaine contre les stéréotypes et préjugés sexistes véhiculés à l’école, de mener une veille stratégique et un plaidoyer pour une école de l’égalité. Afin de constituer une base concrète et solide pour le plaidoyer, il s’agira, dans un premier temps, de réaliser des études et des recherches sur le sujet.
Selon vous, quels types de stéréotypes sont les plus récurrents au sein des établissements scolaires ?
Les établissements scolaires sont encore très imprégnés par les stéréotypes et préjugés sexistes. Les plus récurrents sont ceux relatifs aux traits de personnalité et aux corps des filles et des garçons. Certains traits de personnalité sont assignés aux femmes, tels que la nature émotive agissant en étroite connexion avec les émotions et les sentiments, sachant que la difficulté à contrôler ses émotions influerait sur la capacité à prendre des décisions rationnelles. D’autres sont liés aux hommes, soulignant leur force de caractère, leurs tendances affirmées et compétitives. La perception inégalitaire des corps attribue un corps faible aux filles et un corps fort aux garçons, sans pour autant définir de quel type de force il s’agit. Par ailleurs, si le corps des filles est perçu comme plus faible, il est aussi considéré comme une source de perturbation nécessitant un contrôle. Cette distinction fondamentale entre les hommes et les femmes en termes de caractéristiques personnelles conduit à des répercussions sociales sur l’égalité de genre, notamment sur les rôles assignés aux femmes et aux hommes et sur leurs positions dans la société.
Malgré les réformes et les discours en faveur de l’égalité, pourquoi l’école marocaine peine-t-elle encore à devenir un espace réellement égalitaire, d’après vous ?
L’école marocaine peine à devenir un espace égalitaire en raison du manque d’une vision fondée sur le principe universel de l’égalité, d’une stratégie de mise en œuvre à travers l’ensemble des composantes du système, d’une planification budgétisée inscrite dans la durée, et enfin, d’un dispositif de suivi, d’évaluation, d’adaptation et de développement continu.
Un des facteurs explicatifs réside aussi dans la dimension temporelle des interventions, marquée par la prédominance du temps politique court, lié aux personnes, au détriment du temps pédagogique structurel et institutionnel.
Quelles sont, selon vous, les priorités urgentes à traiter pour faire avancer l’égalité des genres dans l’éducation ?
L’égalité entre les sexes n’est ni une partie d’un programme, ni un cours, ni une activité... Ce n’est pas une composante à greffer sur l’existant. Elle doit être intégrée de manière transversale dans toutes les composantes du système éducatif dans le cadre d’une institutionnalisation. L’approche doit être centrée sur ce que les garçons et les filles apprennent au quotidien. Pour cela, les priorités sont : la révision des curricula et des programmes, la formation à la culture de l’égalité destinée aux différents intervenants du système éducatif (personnel enseignant et administratif), la mise en place d’un système de suivi et d’évaluation des pratiques au quotidien, des moyens financiers inscrits au Budget de l’État/ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, la sensibilisation des parents d’élèves, et des partenariats diversifiés et stratégiques.
Quelle place occupe la formation des enseignants dans votre vision d’une école égalitaire ? Faut-il rendre cette formation obligatoire dans les programmes de l’Éducation nationale ?
L’approche à privilégier doit être centrée sur ce que les élèves apprennent au quotidien, essentiellement par leurs enseignant(e)s. De ce fait, la formation du personnel enseignant est indispensable. Elle doit être obligatoire et porter sur trois volets :
• La formation aux valeurs et principes des droits humains largement consacrés par la Constitution de notre pays, dans leur sens et portée universels et indivisibles, en s’appuyant sur les acquis et en tirant surtout les leçons nécessaires de l’inaboutissement du Programme national d’éducation aux droits de l’Homme.
• La formation à la spécificité des aspects didactiques liés au traitement des contenus relatifs à la culture des droits humains, dont l’égalité homme-femme, et aux techniques de déconstruction des stéréotypes sexistes.
• La formation aux méthodes pédagogiques réellement participatives, permettant aux apprenant(e)s de s’approprier les valeurs en leur laissant l’espace nécessaire pour réfléchir, questionner, interagir, expérimenter, produire, créer, s’exprimer librement, faire des erreurs, les corriger individuellement et en groupe.
• La formation du personnel administratif est également indispensable, car une bonne partie de la vie scolaire est gérée par l’administration des établissements.
Quel rôle les familles et la société civile peuvent-elles jouer pour accompagner ce changement au sein des écoles ?
Les parents d’élèves doivent également être impliqués dans ce processus. C’est pourquoi l’ADFM avait, dès le départ, cherché et obtenu le soutien des fédérations des associations de parents d’élèves. Les parents doivent être sensibilisés. Leur rôle dans l’accompagnement de ce changement est de permettre une cohérence entre ce que l’élève apprend à l’école et ce qui lui est transmis au sein de sa famille. Cette cohérence est indispensable pour son équilibre et pour la pérennisation des résultats. La société civile peut jouer un rôle crucial. Elle complète l’action de l’État par des initiatives concrètes et peut mener une veille stratégique.
Enfin, quel message aimeriez-vous adresser aux décideurs aujourd’hui pour qu’ils traduisent votre ambition d’égalité en actes concrets ?
Dans le contexte actuel, nous avons une opportunité à ne plus manquer pour institutionnaliser l’égalité à travers l’école. Je voudrais rappeler ici cette phrase du mémorandum de l’ADFM :
«Si les constats sont là, les remèdes le sont également.» Seule une démarche volontariste, consciente des enjeux éducatifs, politiques et stratégiques de l’égalité homme-femme en tant que culture, pourrait faire la différence, en ces temps où le monde change à une allure tellement rapide qu’une autre occasion manquée serait fatale. n
Widad Bouab : La dynamique «Pour une école de l’égalité» est née suite à l’initiative citoyenne lancée, sous le même intitulé, par l’Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM) en décembre 2022, et qui a été soutenue par des centaines d’associations féministes, de défense des droits humains et de développement, ainsi que par les syndicats de l’enseignement, les organismes représentant les inspecteur(trice)s pédagogiques, les associations de professeur(e)s de diverses disciplines, ainsi que les fédérations des associations de parents d’élèves.
Cette initiative a également bénéficié d’un soutien particulier d’anciens ministres de l’Éducation nationale. Toutes ces parties s’entendaient sur le fait que, malgré les nombreuses réformes juridiques et institutionnelles qui se sont succédé au Maroc en faveur de l’égalité des sexes, et malgré les progrès réalisés en termes d’augmentation des taux de scolarisation et de réduction des disparités entre les sexes, l’école ne joue pas encore pleinement son rôle dans l’éducation à l’égalité. Bien au contraire, les stéréotypes sexistes sont encore largement véhiculés par les différents intervenants et acteurs pédagogiques dans les espaces scolaires d’éducation et de formation.
Les activités menées par l’ADFM dans le cadre de cette initiative étaient :
• Élaboration d’un mémorandum «Pour l’école de l’égalité entre les deux sexes».
• Présentation du mémorandum au ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports en décembre 2022.
• Signature d’un appel par environ 150 associations et réseaux.
• Rencontre et journée d’étude avec les parlementaires de la Commission éducation, culture et communication de la Chambre des représentants en décembre 2022.
• Lancement d’une campagne de sensibilisation à l’échelle nationale.
• Organisation d’une table ronde le 24 janvier 2023 à Rabat, à l’occasion de la Journée internationale de l’éducation. Lors de cette table ronde, la discussion a montré la nécessité d’un travail de longue haleine, d’une collaboration et d’une coordination qui s’inscrivent dans la durée entre les ONG travaillant sur ce dossier. C’est de là qu’est née l’idée de création d’une dynamique que nous avons intitulée «Pour une école de l’égalité», et qui regroupe différentes ONG. Elle a été créée dans un contexte marqué, au niveau du système éducatif, par le programme gouvernemental (2021-2026), la loi-cadre sur l’éducation et la formation qui met en exergue «la nouvelle école», la Feuille de route pour les prochaines années et l’appel émanant du «Sommet de l’ONU sur la transformation de l’éducation» organisé en septembre 2022, avec la participation du Maroc, sur la question de «la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des filles et des femmes dans et par l’éducation».
Quels sont les objectifs concrets que vous espérez atteindre à court et moyen terme grâce à cette initiative ?
La dynamique vise la promotion de la culture de l’égalité dans la société en se focalisant sur le système éducatif en tant que vecteur principal de socialisation. La synergie des efforts inscrits dans la durée des différentes composantes de la dynamique constituerait un effet multiplicateur nécessaire pour atteindre les objectifs escomptés, étant donné la complexité de la problématique. En effet, la promotion de la culture de l’égalité est un processus lent et long, car elle concerne les mentalités.
Les objectifs à court et moyen terme sont de sensibiliser les intervenant(e)s dans le domaine contre les stéréotypes et préjugés sexistes véhiculés à l’école, de mener une veille stratégique et un plaidoyer pour une école de l’égalité. Afin de constituer une base concrète et solide pour le plaidoyer, il s’agira, dans un premier temps, de réaliser des études et des recherches sur le sujet.
Selon vous, quels types de stéréotypes sont les plus récurrents au sein des établissements scolaires ?
Les établissements scolaires sont encore très imprégnés par les stéréotypes et préjugés sexistes. Les plus récurrents sont ceux relatifs aux traits de personnalité et aux corps des filles et des garçons. Certains traits de personnalité sont assignés aux femmes, tels que la nature émotive agissant en étroite connexion avec les émotions et les sentiments, sachant que la difficulté à contrôler ses émotions influerait sur la capacité à prendre des décisions rationnelles. D’autres sont liés aux hommes, soulignant leur force de caractère, leurs tendances affirmées et compétitives. La perception inégalitaire des corps attribue un corps faible aux filles et un corps fort aux garçons, sans pour autant définir de quel type de force il s’agit. Par ailleurs, si le corps des filles est perçu comme plus faible, il est aussi considéré comme une source de perturbation nécessitant un contrôle. Cette distinction fondamentale entre les hommes et les femmes en termes de caractéristiques personnelles conduit à des répercussions sociales sur l’égalité de genre, notamment sur les rôles assignés aux femmes et aux hommes et sur leurs positions dans la société.
Malgré les réformes et les discours en faveur de l’égalité, pourquoi l’école marocaine peine-t-elle encore à devenir un espace réellement égalitaire, d’après vous ?
L’école marocaine peine à devenir un espace égalitaire en raison du manque d’une vision fondée sur le principe universel de l’égalité, d’une stratégie de mise en œuvre à travers l’ensemble des composantes du système, d’une planification budgétisée inscrite dans la durée, et enfin, d’un dispositif de suivi, d’évaluation, d’adaptation et de développement continu.
Un des facteurs explicatifs réside aussi dans la dimension temporelle des interventions, marquée par la prédominance du temps politique court, lié aux personnes, au détriment du temps pédagogique structurel et institutionnel.
Quelles sont, selon vous, les priorités urgentes à traiter pour faire avancer l’égalité des genres dans l’éducation ?
L’égalité entre les sexes n’est ni une partie d’un programme, ni un cours, ni une activité... Ce n’est pas une composante à greffer sur l’existant. Elle doit être intégrée de manière transversale dans toutes les composantes du système éducatif dans le cadre d’une institutionnalisation. L’approche doit être centrée sur ce que les garçons et les filles apprennent au quotidien. Pour cela, les priorités sont : la révision des curricula et des programmes, la formation à la culture de l’égalité destinée aux différents intervenants du système éducatif (personnel enseignant et administratif), la mise en place d’un système de suivi et d’évaluation des pratiques au quotidien, des moyens financiers inscrits au Budget de l’État/ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, la sensibilisation des parents d’élèves, et des partenariats diversifiés et stratégiques.
Quelle place occupe la formation des enseignants dans votre vision d’une école égalitaire ? Faut-il rendre cette formation obligatoire dans les programmes de l’Éducation nationale ?
L’approche à privilégier doit être centrée sur ce que les élèves apprennent au quotidien, essentiellement par leurs enseignant(e)s. De ce fait, la formation du personnel enseignant est indispensable. Elle doit être obligatoire et porter sur trois volets :
• La formation aux valeurs et principes des droits humains largement consacrés par la Constitution de notre pays, dans leur sens et portée universels et indivisibles, en s’appuyant sur les acquis et en tirant surtout les leçons nécessaires de l’inaboutissement du Programme national d’éducation aux droits de l’Homme.
• La formation à la spécificité des aspects didactiques liés au traitement des contenus relatifs à la culture des droits humains, dont l’égalité homme-femme, et aux techniques de déconstruction des stéréotypes sexistes.
• La formation aux méthodes pédagogiques réellement participatives, permettant aux apprenant(e)s de s’approprier les valeurs en leur laissant l’espace nécessaire pour réfléchir, questionner, interagir, expérimenter, produire, créer, s’exprimer librement, faire des erreurs, les corriger individuellement et en groupe.
• La formation du personnel administratif est également indispensable, car une bonne partie de la vie scolaire est gérée par l’administration des établissements.
Quel rôle les familles et la société civile peuvent-elles jouer pour accompagner ce changement au sein des écoles ?
Les parents d’élèves doivent également être impliqués dans ce processus. C’est pourquoi l’ADFM avait, dès le départ, cherché et obtenu le soutien des fédérations des associations de parents d’élèves. Les parents doivent être sensibilisés. Leur rôle dans l’accompagnement de ce changement est de permettre une cohérence entre ce que l’élève apprend à l’école et ce qui lui est transmis au sein de sa famille. Cette cohérence est indispensable pour son équilibre et pour la pérennisation des résultats. La société civile peut jouer un rôle crucial. Elle complète l’action de l’État par des initiatives concrètes et peut mener une veille stratégique.
Enfin, quel message aimeriez-vous adresser aux décideurs aujourd’hui pour qu’ils traduisent votre ambition d’égalité en actes concrets ?
Dans le contexte actuel, nous avons une opportunité à ne plus manquer pour institutionnaliser l’égalité à travers l’école. Je voudrais rappeler ici cette phrase du mémorandum de l’ADFM :
«Si les constats sont là, les remèdes le sont également.» Seule une démarche volontariste, consciente des enjeux éducatifs, politiques et stratégiques de l’égalité homme-femme en tant que culture, pourrait faire la différence, en ces temps où le monde change à une allure tellement rapide qu’une autre occasion manquée serait fatale. n